|
[ ÉDITORIAL ]
|
|
« Écrasement » des comprimés : tout n’est pas permis!
Dans les services de gériatrie, le problème de déglutition des malades pousse souvent le personnel soignant à couper ou à pulvériser un comprimé ou d’ouvrir une gélule. Mais d’après une enquête publiée dans la revue médecine interne, dans 42% des cas, ces manipulations sont contre indiquées (1).
Ces contre-indications se justifient par un surdosage du médicament broyé ou ouvert ou par une toxicité locale. Elles peuvent aussi se justifier par une modification des propriétés physico-chimiques, pharmacocinétiques et ou pharmacodynamiques pouvant provoquer, selon les cas, une baisse d’efficacité ou un surdosage du médicament concerné.
Pour éviter ces contre-indications, les professionnels de santé peuvent être amenés à consulter le RCP des produits concernés. Ils y trouvent, dans bien des cas, des mentions telles que : «ne doit pas être croqué ou écrasé», «peut être dilué dans un verre d’eau», «doit être avalé entier», etc.
D'une manière générale, on doit éviter d’ouvrir, de couper ou d’écraser les comprimés gastro-résistants, à libération modifiée ou contenant des substances instables à l’air ou à la lumière. De même qu’on ne peut pas diviser des médicaments ne contenant pas de rainures en raison d’éventuelles erreurs de dosage. Ceci est particulièrement vrai pour les médicaments ne disposant que d'une fenêtre thérapeutique étroite. Dans ces cas, il vaut mieux opter pour une autre présentation galénique se prêtant plus facilement à la division.
Pour aider les professionnels à s’y retrouver, le groupe de gérontologie de la SFPC(2) (Société Française de pharmacie clinique) a élaboré un tableau regroupant tous les comprimés pouvant être écrasés et les gélules pouvant être ouvertes avec des recommandations pour chaque spécialité énumérée.
Au Maroc, les pharmaciens et les médecins sont parfois confrontés à des situations où il doivent savoir si un comprimé peut être broyé ou si une gélule peut être ouverte avant son administration. Souvent, il s’agit de personnes âgées ou d’enfants. Ils doivent, donc, disposer de données probantes leur permettant de se renseigner sur la pertinence d’une telle pratique, et le cas échéant, pouvoir proposer d’autres formes galéniques ou une autre spécialité se prêtant davantage au broyage.
Enfin, on ose espérer que les professionnels de santé finiront par élaborer une liste nationale des comprimés pouvant être écrasés et des gélules pouvant être ouvertes. En attendant, on peut toujours consulter la liste de la SFPC, mais on ne peut y trouver que certains princeps commercialisés au Maroc.
Abderrahim DERRAJI
(1) "L'écrasement des médicaments e, gériatrie, une pratique artisanale avec de fréquentes erreurs qui nécessitait des recommandations"
M. Caussin et al. La revue de médecine interne, 33 (2012), p. 546-551, Elsevier Masson
(2) Lien
|
|
|
Revue de presse

|
 Une équipe du CHU Mohammed VI d'Oujda réalise une chirurgie cardiaque minutieuse
Une équipe du CHU Mohammed VI d'Oujda réalise une chirurgie cardiaque minutieuse
Au Centre hospitalier Mohammed VI d'Oujda, un staff médical composé de chirurgiens cardiologues et d'anesthésistes-réanimateurs a réussi une grande première. En effet, l’équipe a réalisé une intervention chirurgicale minutieuse au niveau du cœur d'un patient, une première du genre dans la région de l'Oriental.
Cette intervention a consisté à déboucher l’artère coronaire, chez un sexagénaire atteint d’un dysfonctionnement du ventricule gauche du cœur et qui souffrait d'autres complications, indique le ministère de la Santé dans un communiqué.
Grâce à cette intervention, le Centre hospitalier Mohammed VI d'Oujda aura contribué à renforcer davantage l’offre de santé dans la région de l’Oriental, particulièrement en matière d'interventions de 3e degré et à alléger la souffrance de patients qui devaient se rendre vers d'autres centres hospitaliers du Royaume.
Source : Le Matin
|
|
|
 Le traitement préventif du VIH autorisé en France
Le traitement préventif du VIH autorisé en France
En autorisant le recours au Truvada (embricitabine + ténofovir) dans la prévention du VIH par le biais d’une RTU, la France élargit désormais sa prescription aux médecins expérimentés dans la prise en charge du VIH et qui exercent dans l'un des 300 Centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic (CeGIDD).
Les nouvelles règles de prescription de cette prophylaxie pré-exposition (PrEP) sont fixées par un arrêté paru au « Journal officiel ».
La ministre de la Santé française, avait annoncé cette décision dans le cadre de la réunion de haut niveau de l’assemblée générale des Nations unies sur la fin du SIDA, qui s'est tenue à New York. L’été dernier, cette ville avait débuté une promotion active de l’usage du Truvada. « Grâce aux tests rapides d’orientation diagnostique (TROD), aux autotests et à la PrEP par le Truvada, nous allons vers toutes les populations, même les plus éloignées du système de santé, voilà la clé pour combattre, et à terme éradiquer le virus du Sida », déclare Marisol Touraine, qui rappelle toutefois que la PrEP n’a pas vocation à se substituer au préservatif, moyen de prévention prioritaire, efficace dans 99 % des cas contre le SIDA.
Source : Le Quotidien du Pharmacien
|
|
|
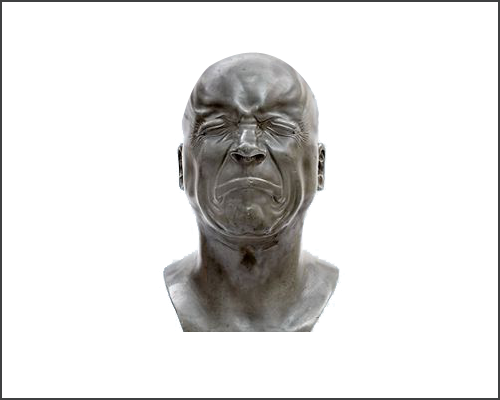 La migraine, un autre facteur de risque d’accident cardiovasculaire
La migraine, un autre facteur de risque d’accident cardiovasculaire
La migraine, et particulièrement la migraine avec aura, est associée au risque d'accident vasculaire cérébral (AVC), tant ischémique qu'hémorragique. Les mécanismes par lesquels passe ce lien ne sont pas encore parfaitement élucidés. Plusieurs paramètres sont sans doute impliqués, parmi lesquels la dysfonction endovasculaire, la sensibilité à la thrombose, l'augmentation des facteurs de risque cardiovasculaires, des facteurs génétiques, une diffusion particulière de la dépolarisation corticale et l'inflammation.
Pour savoir si la migraine pouvait ou non être considérée comme un facteur de risque cardiovasculaire, une équipe états-unienne a réalisé une étude prospective de cohorte avec 115 541 femmes âgées de 25 à 42 ans à l'entrée et indemnes de maladies cardiovasculaires initialement, suivies entre 1989 et 2011. Parmi ces participantes près de 18 000 (15,2 %) souffraient de migraine diagnostiquée par une médecin. Au cours du suivi de plus de 20 ans, 1 329 accidents cardiovasculaires majeurs sont survenus et 223 décès de cause cardiovasculaire.
Après ajustement pour les facteurs confondants, la migraine apparaît en effet associée à une augmentation du risque d'accident cardiovasculaire majeur, d'infarctus du myocarde, d'AVC et de procédure de revascularisation coronaire.
La migraine est aussi associée à une augmentation du risque de mortalité de cause cardiovasculaire. Le tabagisme, l'hypertension, la prise d'un traitement hormonal substitutif ou d'un contraceptif oral ne changent rien à l'association de la migraine avec le risque d'accident cardiovasculaire.
Selon les auteurs, le résultat de cette étude autorise l'hypothèse selon laquelle la physiopathologie de la migraine participerait réellement à une maladie systémique qui affecte le système endovasculaire. Aucune étude n'a toutefois montré jusqu'à présent que la prévention des crises de migraine réduit le risque cardiovasculaire.
Source : JIM
|
|
|
 Qui sont ces bactéries résistantes aux antibiotiques ?
Qui sont ces bactéries résistantes aux antibiotiques ?
Les bactéries mutent en permanence pour tenter d'échapper à l'action des antibiotiques. Plus on utilise des molécules puissantes, dites «à large spectre», plus le risque augmente de voir apparaître des bactéries qui leur résistent.
Dans les années 1980 sont apparus les premiers germes producteurs de bêta-lactamases à spectre étendu (BLSE), des enzymes qui rendent les bactéries insensibles à l'action des antibiotiques de la famille des bêta-lactamines.
Ce sont les premiers responsables d'infections à l'hôpital, mais aussi en ville où l'on voit émerger depuis quelques années des souches d'Escherichia coli, qui font partie des entérobactéries, productrices de BLSE. Cette résistance croissante pousse à utiliser des antibiotiques à plus large spectre, ce qui augmente le risque de sélectionner des souches encore plus résistantes.
Pour surmonter cet écueil, les chercheurs ont commencé à développer, il y a une vingtaine d'années, une nouvelle famille d'antibiotiques: les carbapénèmes. Il s'agit en quelque sorte d'antibiotiques de dernier recours, pour faire face aux entérobactéries productrices des BLSE. Sans surprise, la réponse bactérienne ne s'est pas fait attendre: dès les années 2000, les microbiologistes découvraient les premières entérobactéries productrices de carbapénèmases (EPC). Elles sont résistantes à l'ensemble des carbapénèmes, à des niveaux différents (inefficacité totale ou partielle). Elles le sont aussi très souvent à d'autres antibiotiques parmi les plus puissants, comme les céphalosporines de troisième génération. Autant dire qu'une infection à EPC réduit drastiquement les possibilités de traitement.
Deux méthodes coexistent pour rechercher les EPC. La première repose sur la mise en culture d'un prélèvement rectal, réalisé chez le patient. Le résultat est obtenu en 48 heures. La seconde utilise la biologie moléculaire et consiste à rechercher les gènes qui codent pour les différentes carbapénèmases.
La bataille contre les super-bactéries s'organise également sur le terrain de la prévention. Pour réussir, nous devons impérativement remporter deux victoires. La première, c'est une hygiène rigoureuse des mains. La seconde, c'est le bon usage des antibiotiques, dans l'espèce humaine mais aussi chez les animaux d'élevage. Administrer larga manu des antibiotiques à des poules ou à des vaches, c'est risquer de sélectionner des bactéries multirésistantes dans leur flore intestinale et de retrouver ces mêmes bactéries dans notre assiette! C'est ainsi que les BLSE ont émergé.
Source : http://sante.lefigaro.fr
|
|
|
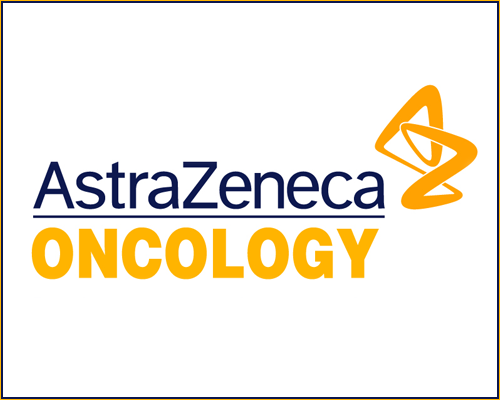 AstraZeneca va fortement augmenter ses revenus en oncologie
AstraZeneca va fortement augmenter ses revenus en oncologie
AtraZeneca dispose d’un pipeline de molécules très varié dans l’oncologie.
Le groupe arrive sur le marché de l'immunothérapie derrière BMS, Merck, Roche, mais il joue d'emblée la carte des combinaisons (13 phases III) pour se démarquer des autres.
AstraZeneca a fait le choix d'essais cliniques de phase III dans la catégorie la plus répandue de cancers du poumon (de 70 à 80 % des cas). C'est un des plus gros marchés du cancer. Plusieurs scénarios sont maintenant possibles, explique Pascal Soriot, PDG d'AstraZeneca. « Soit la combinaison des deux molécules n'est pas plus efficace que l'un des composants seul et alors, arrivant en quatrième position, ce sera une bataille de marketing. Ou bien notre combinaison va bénéficier aux nombreux patients jusque-là mal traités par les produits concurrents et nous serons les premiers sur ce segment. » Troisième option, la combinaison est efficace pour tous les patients. « C'est un peu le scénario de rêve », conclut le patron d'AstraZeneca.
En plus de ses deux produits d'immunothérapie, AstraZeneca dispose aussi dans son pipeline de molécules relevant d'autres approches pouvant se combiner entre elles ou avec les produits d'immunothérapie : des anticorps porteurs de molécules de chimiothérapie, dits « anticorps conjugués », des molécules ciblant les mécanismes de résistance des cellules cancéreuses et enfin des molécules empêchant la réparation de l'ADN. AstraZeneca attend beaucoup de cette piste, qui conduit les cellules cancéreuses à la mort, faute de réparer leur ADN. Son premier produit de ce type, le Lynparza, a été approuvé dans le traitement de certains cancers de l'ovaire.
La cancérologie, qui représente aujourd'hui 12 % du chiffre d'affaires du groupe, va fortement augmenter dans les années à venir. Le lancement du Tagrisso contre certains cancers du poumon en est la préfiguration. Et ce d'autant plus qu'AstraZeneca a perdu son brevet sur sa statine phare, le Crestor.
Source : www.lesechos.fr
|
|
|
|







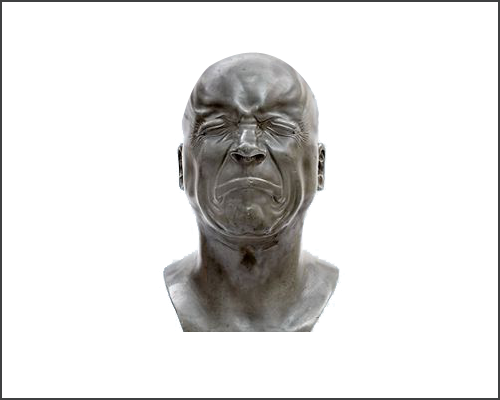

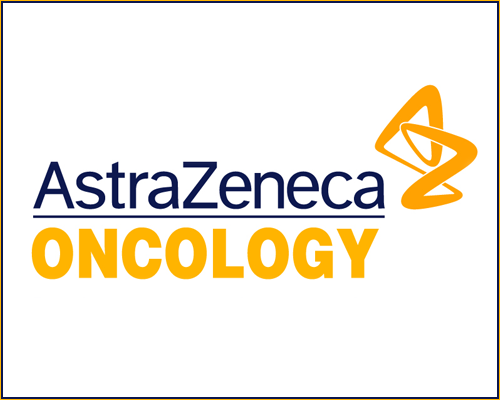
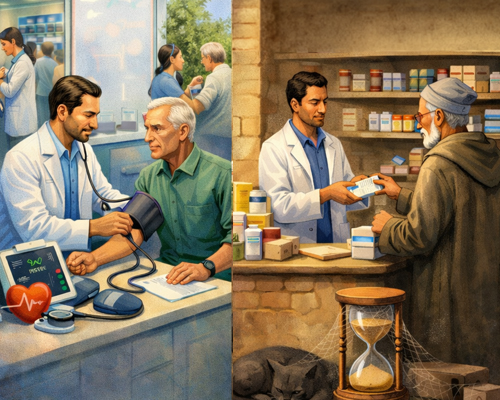
.jpg)
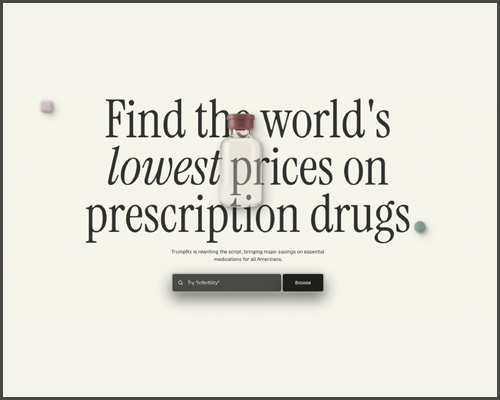
.jpg)